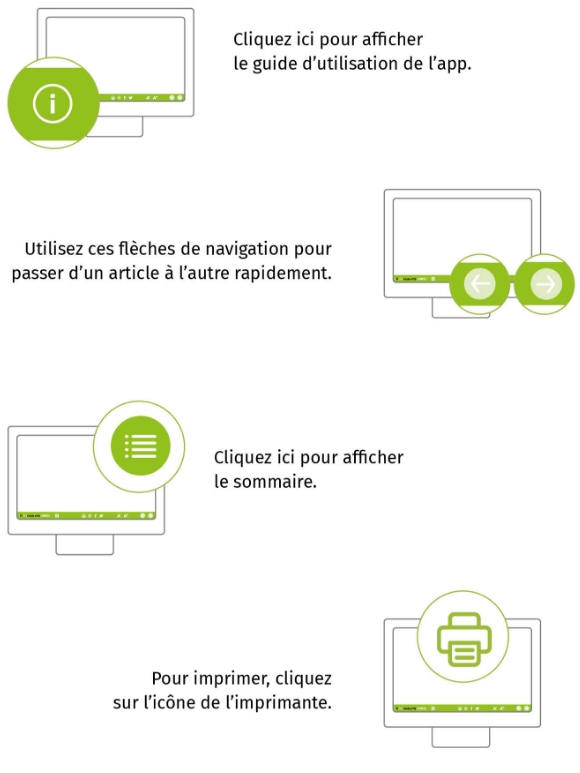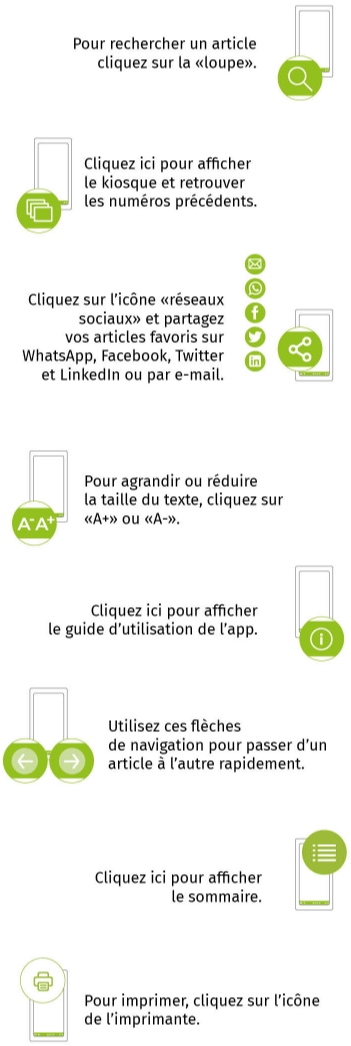Le sommaire
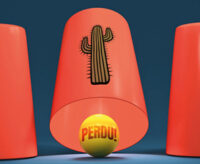



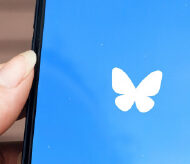
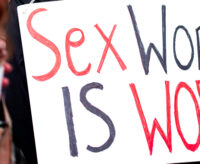




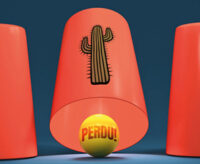



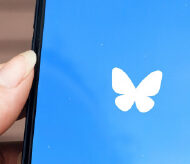
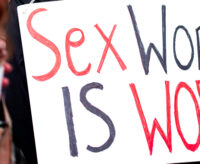





Les cellules de reconversion: rebondir après le deuil de son emploi
Dans les mois à venir, un très grand nombre de travailleurs impactés par un licenciement collectif ou une faillite vont entrer dans le dispositif de reclassement professionnel proposé par les cellules de reconversion. Alain Rzeznik et Hafed Abrayem, qui les coordonnent à l’ASBL Réso, reviennent sur les spécificités de ces cellules.
Propos recueillis par David Morelli


Alain Rzeznik et Hafed Abrayem, de l’ASBL Réso.
Le dispositif a été créé en 1977 à l’initiative de la CSC et de la FGTB. L’idée était de créer un partenariat avec le Forem pour que les travailleurs victimes du licenciement collectif lors de la fermeture de l’entreprise S.A. Minière et Métallurgique à Rodange Athus aient un point de chute pour se retrouver avec leurs collègues et être orientés et aidés dans leur recherche d’emploi. En 2004, le décret wallon a institutionnalisé les CR. Progressivement, elles se sont regroupées dans des plateformes – il en existe neuf en Wallonie – au sein desquelles se trouvent les conseillers du Forem et les accompagnateurs sociaux, souvent d’anciens délégués syndicaux.
Le cadre fédéral oblige l’employeur à proposer un accompagnement des travailleurs des entreprises qui licencient collectivement. Cet accompagnement peut se faire via un opérateur d’outplacement privé ou, pour les travailleurs domiciliés en Wallonie, via le dispositif des CR, à la demande d’une organisation syndicale. La CPE est l’organe administratif qui veille à l’exécution concrète des mesures.
La CR est le lieu physique où sont remplies ces obligations légales. Par ailleurs, le champ d’intervention des CR est plus large que celui prévu au niveau fédéral puisqu’il inclut les travailleurs impactés par une faillite. Mais ces derniers n’ont aucune obligation d’être accompagnées en CR. Ce sont les organisations syndicales qui déterminent s’il est utile de le proposer.
Une autre différence avec le dispositif fédéral, c’est que nous sommes dans un dispositif permettant un accompagnement de douze mois, avec l’obligation, pour certains publics qui relèvent des obligations au niveau fédéral, d’être accompagnés pour une période de trois mois (pour les moins de 45 ans) ou de six mois (pour les plus de 45 ans). À l’issue de cette période, les travailleurs peuvent sortir du dispositif et rejoindre le cycle classique de recherche d’emploi avec le Forem.
75%
C’est le taux de remise à l’emploi des CR en 2023.
Nous les accompagnons dans toutes les démarches administratives auxquelles ils doivent faire face. Nous vérifions les C4, par exemple. Le Forem va s’occuper de l’aspect formation et recherche d’emploi. Mais le point d’ancrage des CR, avant même la recherche et la remise à l’emploi, c’est l’aspect humain, la reconstruction du travailleur durant le deuil que constitue un licenciement. De nombreux travailleurs pensent qu’ils ne savent rien faire d’autre que ce qu’ils ont fait durant leur carrière. Nous travaillons avec eux cet aspect pour leur montrer qu’ils ont énormément de compétences transversales. Cette remise en confiance peut se répercuter sur plein d’autres choses: remise à l’emploi, validation de compétences, formations…
La société d’outplacement missionnée par l’entreprise doit présenter des résultats rapides. Elle doit convaincre chaque travailleur de retrouver un emploi le plus rapidement possible, qu’il lui plaise ou pas. Il n’y a pas de prise en compte du fait qu’un travailleur n’est peut-être pas prêt psychologiquement à rechercher ou reprendre tout de suite un nouvel emploi, ou qu’il souhaite peut-être se réorienter vers quelque chose de complètement différent.
Dans les CR, on peut aller très vite ou prendre plus de temps avec ceux qui en ont besoin. On avance à leur rythme. On va également tenir compte des besoins du travailleur et lui proposer un panel d’activités qui va lui permettre de rebondir et de repartir vers sa reconversion. La plus grosse plus-value du dispositif est d’avoir des accompagnateurs syndicaux qui les informeront sur leurs droits et leurs obligations via des séances thématiques, sur la dégressivité du chômage par exemple.
Oui, et il est primordial: le fait de rassembler ces travailleurs qui vivent les mêmes choses au même moment et qui peuvent se soutenir, cela crée une dynamique qui leur permet d’avancer plus facilement vers la reconstruction du projet professionnel. C’est une dimension absente des méthodes des sociétés privées d’outplacement. C’est clairement une de nos grandes forces et plus-value.
Comme mentionné précédemment, notre particularité, c’est que nous sommes un dispositif partenarial: nous travaillons avec des accompagnateurs sociaux. À partir d’un licenciement de 100 travailleurs, nous avons la possibilité de travailler avec des accompagnateurs sociaux d’entreprise (ASE), des anciens délégués d’entreprise qui ont un contrat d’un an pour accompagner les travailleurs. Depuis 2009, nous avons également la possibilité d’avoir des accompagnateurs sociaux permanents (ASP). Ils sont engagés en CDI et sont présents, cinq jours par semaine, sur chacune des neuf plateformes, réparties dans toute la Wallonie.
Le point d’ancrage, avant même la remise à l’emploi, c’est l’aspect humain, la reconstruction durant le deuil du licenciement.
Pour l’année 2023 par exemple, nous avons un taux de remise à l’emploi de 75%. Le taux de réinsertion des plus de 45 ans est également élevé et les emplois vers lesquels nous menons ces demandeurs d’emplois sont de qualité, avec une majorité de CDI. Notre force, c’est d’être en contact avec les fonds sectoriels, ce qui peut nous permettre d’affiner la réflexion pour guider ces publics par rapport à des opportunités d’emploi qui pourraient se développer dans les mois à venir.
Il est sans doute trop tôt pour poser une opinion car on n’a aucune information officielle. Cela dit, le programme du gouvernement donne déjà des indications qui ne sont pas favorables aux cellules de reconversion.
Depuis la mise en place du gouvernement, on entend énormément de bruits de couloir et cela provoque de l’inquiétude: on sait qu’il y aura un impact, mais on ne sait pas encore à quels niveaux cela va affecter le dispositif. Rappelons que le ministre Jeholet avait, en 2017, réduit l’effectif des ASP. Pendant cette période, nous n’avions plus pu offrir un accompagnement avec la même qualité aux travailleurs. C’est cela qui est en jeu. Nous avons l’impression que les bons résultats ne semblent pas intéresser le nouveau gouvernement et que le problème, c’est le partenariat syndical. Pourtant, depuis de nombreuses années, les cellules de reconversion ont fait leurs preuves!
© David Morelli, Shutterstock