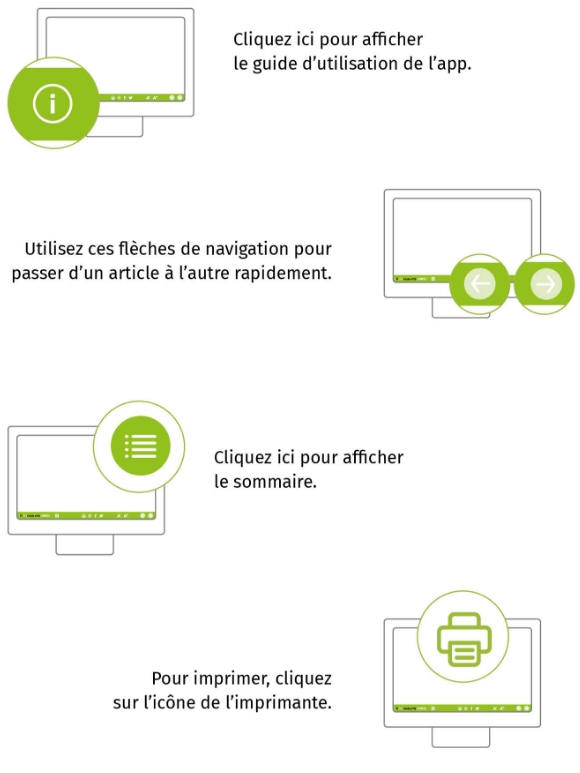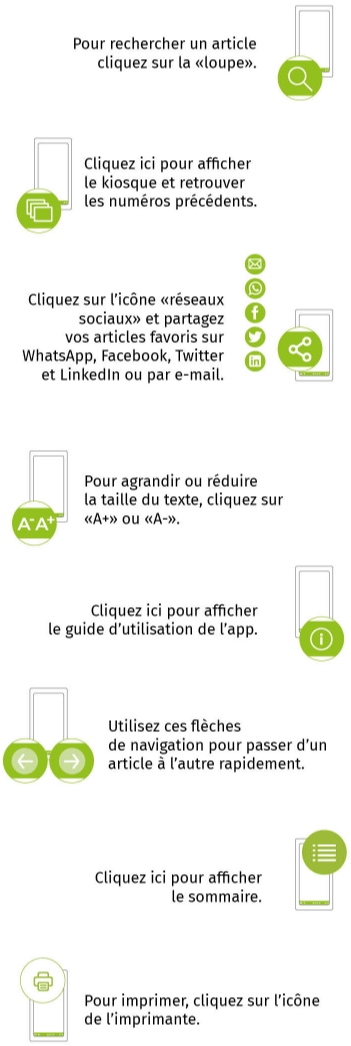Le sommaire























Au-delà du jeu de mot, le titre de cet article, qui met en parallèle le droit de grève et le droit de rêver, est l’illustration très concrète de l’essence même du droit de grève. Mais à la différence d’un rêve, la grève est un moyen très concret qui permet de réaliser les revendications et les aspirations
des travailleurs.
Alexis Fellahi
Les anglo-saxons qualifient le droit de grève de «enabling right» («droit habilitant»). Autrement dit, un droit qui rend possible. En effet, le droit de grève permet d’en réaliser d’autres. Sans le droit de grève, tous ces autres droits sont mis sous pression.
Aujourd’hui toutefois, ce droit fait face à de nombreux périls. Pour qu’il reste un droit qui rend possible, il faudra être particulièrement vigilant aux projets de ceux qui veulent le vider de sa substance.
Actuellement, aucune disposition légale en Belgique n’a pour objet de règlementer directement et explicitement le droit de grève, mais des partisans d’une telle règlementation font entendre leur voix.
C’est ainsi que de nombreuses propositions de loi ont été déposées par divers partis politiques. Le MR a par exemple déposé une proposition de loi visant à définir et garantir la liberté de travailler des travailleurs non-grévistes en cas de grève de leurs collègues. Toute action qui entraverait l’exercice de cette liberté pourrait être sanctionnée pénalement. La N-VA a également déposé une proposition qui va même plus loin puisqu’elle vise à introduire un mécanisme supplétif de règlementation de la conflictualité sociale1 qui s’appliquera s’il n’y a pas de convention collective de travail (CCT) conclue en la matière.
Le Conseil d’État a eu l’occasion de rendre un avis à ce sujet. Il a conclu que sur de nombreux aspects, ces propositions de loi se heurtaient notamment au principe de légalité en droit pénal ou encore au principe de la personnalité des peines, selon lequel on ne peut condamner une personne pour un fait punissable qu’elle n’a pas elle-même commis.
Le gouvernement a également demandé aux interlocuteurs sociaux de mettre à jour le Gentlemen’s agreement de 2002, qui portait notamment sur la manière dont ils entendaient gérer les conflits sociaux. En cas d’échec de ces discussions, il y a fort à craindre que ces deux partis mettent leurs propositions de loi sur la table du gouvernement.
On constate un retour des requêtes unilatérales des employeurs afin d’interdire des grèves.
Une pratique courante dans le passé a récemment connu un retour fulgurant: l’introduction de requêtes unilatérales par les employeurs.
Ces requêtes visent à saisir le président du tribunal de première instance afin d’obtenir une ordonnance rendue sur requête unilatérale (en l’absence de toute partie adverse) afin d’imposer des interdictions assorties d’astreintes. Ces ordonnances sont destinées à être signifiées aux participants aux piquets de grève installés à l’entrée des entreprises.
Cette pratique était extrêmement courante dans le passé et de nombreuses décisions de justice ont donné gain de cause aux employeurs. Les syndicats ont estimé que cette pratique était contraire au droit de grève consacré par la Charte sociale européenne. Ils ont introduit, en 2009, une réclamation auprès du Comité européen des droits sociaux. Celle-ci a été couronnée de succès: le Comité a estimé en 2011 que la pratique des requêtes unilatérales afin de mettre fin aux piquets de grève était contraire à la Charte sociale européenne.
Malgré cette décision, cette pratique a refait surface en mars 2023, avec une ampleur encore jamais vue auparavant, dans le cadre du conflit social au sein de l’entreprise Delhaize. Tant le nombre d’ordonnances rendues sur requêtes unilatérales que le contenu de certaines de ces décisions ont rendu ce conflit social tout à fait particulier. Si son issue judiciaire n’est pas encore définitive, il est à craindre qu’un nouveau passage par le Comité européen des droits sociaux s’impose.
La question de la personnalité juridique des syndicats touche à la question de la liberté syndicale. Or, cette dernière va subir une forte pression de la part de la majorité gouvernementale qui s’est fixée pour objectif de «garantir la protection juridique des syndicats concernant les manifestations et les grèves avec un préavis de grève ou leur rôle dans les entreprises». Cette formulation positive peut sembler inoffensive au premier abord, mais pose de nombreuses questions quant aux modalités concrètes de mise en œuvre.
Le spectre de la personnalité juridique plane derrière cette intention du gouvernement. Si la voie choisie par le gouvernement ne sera pas nécessairement celle d’imposer la personnalité juridique aux syndicats, il semble a minima vouloir introduire des règles de responsabilité plus contraignantes pour ceux-ci dans les cas où les règles de préavis n’auraient pas été respectées.
Ce scénario «a minima» pourrait néanmoins constituer un véritable séisme pour le droit de grève en Belgique qui y est consacré en tant que droit individuel de chaque travailleur. L’évolution présentée par l’accord de gouvernement semble soit ignorer, soit vouloir remettre en cause ce caractère individuel.
La reconnaissance du droit de grève comme un droit individuel implique que ce droit peut être exercé sans l’aval de la structure syndicale. Imposer le respect des règles de préavis pour son exercice revient à priver d’effectivité le droit individuel des travailleurs à faire grève en empêchant la reconnaissance collective de la grève par les syndicats. En effet, bien que reconnu comme un droit individuel, le droit de grève reste un droit qui s’exerce collectivement dans la pratique. Pourtant, seules les organisations syndicales sont tenues par les dispositions obligatoires des conventions collectives de travail qui contiennent les règles en matière de préavis. Concrètement, les syndicats se retrouveraient dans l’impossibilité de reconnaître des actions menées spontanément.
Cette intention du gouvernement touche bel et bien à la capacité d’action et de soutien des travailleurs par les syndicats.
Bien que reconnu comme un droit individuel, le droit de grève, dans la pratique, s’exerce collectivement.
Le droit de grève a toujours fait l’objet de menaces. Ses détracteurs n’ont jamais arrêté de chercher à en affaiblir la portée. Au cours des dernières années, ces menaces ont toujours pu être écartées.
Le contexte actuel nous pousse néanmoins à devoir redoubler de vigilance au vu des intentions du gouvernement et des revers judiciaires récents subis en la matière.
N’oublions surtout pas que la grève, qu’elle soit reconnue comme un droit à part entière ou qu’elle ne soit plus qu’un fait, restera le moyen qui nous permettra de réaliser les revendications et les aspirations des travailleurs lorsque cela s’avérera nécessaire.
1. Ce mécanisme supplétif prévoit des règles très strictes de préavis ainsi que d’informations sur les modalités concrètes de l’organisation de la grève.
© Kristof Vadino