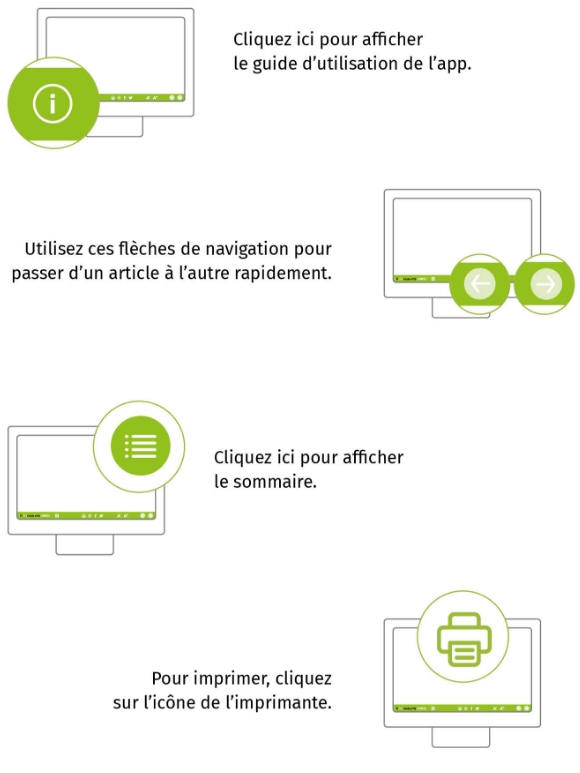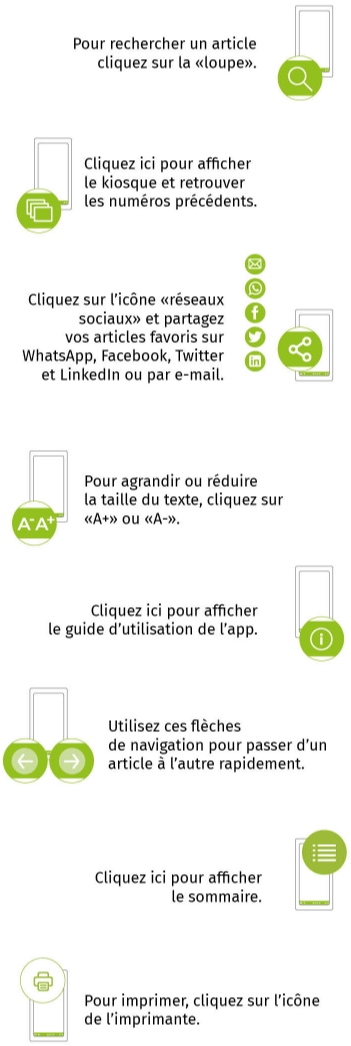Le sommaire





























coupable des enseignes de mode
Les marques de mode doivent protéger les ouvrières et ouvriers de l’industrie textile. Et s’engager contre les violations persistantes des droits humains et syndicaux dans les pays producteurs.
Donatienne Coppieters
24 avril 2013: 1.138 personnes sont tuées et des milliers d’autres blessées par l’effondrement du Rana Plaza, un immeuble du secteur textile au Bangladesh. Dans ces ateliers étaient fabriqués une partie des vêtements d’enseignes de mode que nous portons chaque jour.
24 avril 2025: rue Neuve à Bruxelles. Une centaine de personnes portant banderoles et calicots déambulent lentement dans la rue commerçante. Les passants sont interpellés par les slogans «Rana Plaza, Never again», «Stop Business Impunity», «Des salaires dignes pas la prison», «Au Bangladesh, des travailleurs et travailleuses risquent la prison pour avoir protesté contre des salaires de misère», «Répression au Bangladesh, marques complices: Kiabi, Zara, Aldi, Levi’s, Decathlon, M&S, Bestseller, C&A, Carrefour, H&M, Vans, Matalan, Lidl, Next, Primark, Calvin Klein, Gap, Lee»…
Le groupe fait une halte devant les magasins de quatre enseignes dont les chaînes d’approvisionnement sont entachées de répression syndicale: Zara, H&M, C&A et Primark.
Il y a 12 ans, après la pire catastrophe industrielle de l’histoire moderne de l’habillement, les grandes marques avaient promis qu’il y aurait un «avant» et un «après» Rana Plaza. Mais les promesses de transformation de l’industrie de la mode restent largement lettre morte dénoncent les plateformes achACT et Schone Kleren Campagne, une large coalition d’organisations syndicales – dont la CSC – et d’ONG – dont WSM.
En 2013, sous la pression de la société civile, certaines marques acceptent de signer un Accord sur la santé et la sécurité. Mais celui-ci est géographiquement limité – principalement au Bangladesh et au Pakistan – et n’aborde qu’une partie des problèmes. Des droits essentiels, comme la liberté syndicale ou le versement d’un salaire vital, dépendent encore du bon vouloir des enseignes. En novembre 2023, des manifestations ouvrières au Bangladesh sont violemment réprimées lors du processus de révision salariale, dans le silence assourdissant des marques et enseignes de mode…
Au Bangladesh, des travailleurs et travailleuses risquent la prison pour avoir protesté contre des salaires de misère»
De plus, malgré les preuves de l’efficacité de l’Accord, certaines marques, dont Decathlon, Amazon, Ikea ou Urban Outfitters, continuent de s’en tenir à des engagements volontaires. En refusant de signer des accords juridiquement contraignants, elles exposent leurs travailleurs à des risques bien connus ou nouveaux, liés au changement climatique: vagues de chaleur, inondations, conditions de travail de plus en plus extrêmes.
En avril 2024, lors du onzième anniversaire du drame, le Parlement européen adoptait la directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. Ce texte ouvrait la voie à une responsabilisation réelle des multinationales vis-à-vis des violations sociales et environnementales dans leurs chaînes de production.
Mais à peine un an plus tard, cette avancée historique est déjà menacée: une «proposition omnibus» émise par la Commission européenne cherche à édulcorer le texte initial!
La Clean Clothes Campaign appelle donc à la fois les marques et les institutions européennes à faire preuve de courage: en signant des accords juridiquement contraignants, en renforçant la législation européenne, et en mettant enfin un terme à l’ère du greenwashing et du socialwashing.
Signez la pétition demandant à Kontoor Brands (Wrangler, Lee) ainsi qu'à 11 autres grandes marques de signer l'accord sur cleanclothes.org.
© Kristof Vadino