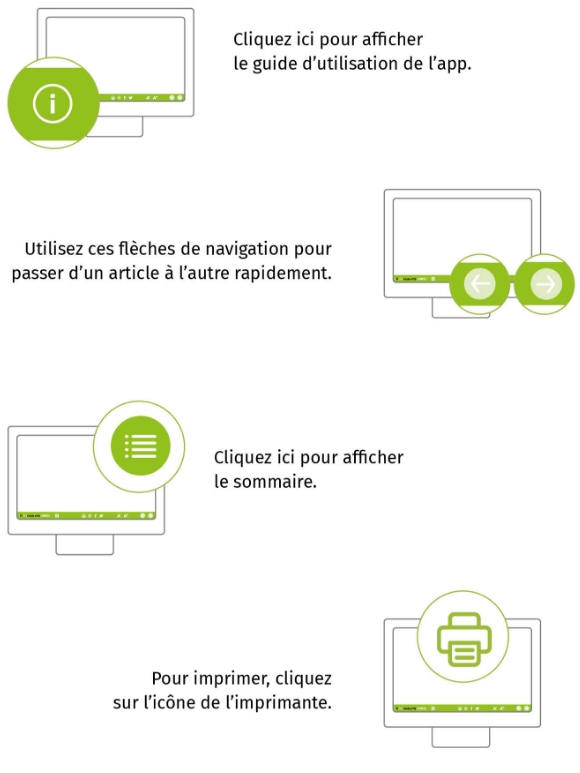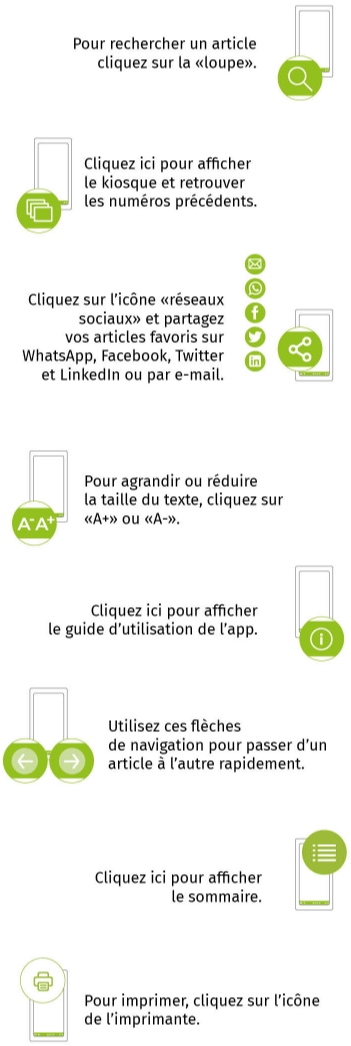Le sommaire
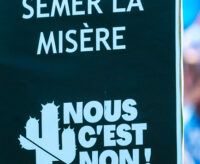












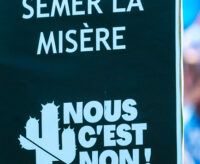













Ils n’ont pas remporté une troisième Palme d’Or à Cannes, mais les frères Dardenne, cinéastes de renom, prouvent une fois encore avec «Jeunes mères» – film poignant sur des mères adolescentes – qu’ils n’ont rien perdu de leur classe. Dans une société où domine le culte de l’individu, avoir besoin des autres est souvent perçu comme une faiblesse.
Lies Van der Auwera
Montrer ceux qui vivent en marge de la société, sans artifices ni jugements: c’est là qu’excellent les frères Dardenne depuis des décennies. En témoignent Rosetta, L’Enfant ou Le gamin au vélo, leurs œuvres majeures. Même Martin Scorsese (Le Loup de Wall Street, Les Infiltrés, Les Affranchis) ne tarit pas d’éloges sur le talent des deux cinéastes wallons.
Luc: «Nous avons grandi dans un village près de Seraing (Liège, ndlr), une région connue pour son industrie lourde, principalement la sidérurgie et la métallurgie. Dans notre jeunesse, Seraing était une ville populaire et pleine de vie.»
Jean-Pierre: «À la fin des années 1970, tout a basculé: l'industrie a fermé ses portes, les commerces et les cafés aussi, les rues se sont vidées, les loyers ont chuté. Pourtant, on sentait encore une solidarité profonde, héritée des longues luttes ouvrières. C’est là que se trouve l’inspiration de nos films.»
Luc: «Dans notre rue, nous étions la seule famille d’employés. Notre père était dessinateur industriel, et nous avions une chambre en plus dans la maison, mais tous nos amis venaient de familles ouvrières.»
«Comme nous n’avions pas les moyens d’acheter une caméra, nous avons d’abord travaillé à la centrale nucléaire de Tihange, alors en construction. Notre idée était simple: recueillir des histoires dans le quartier, souvent autour d’injustices ou de résistances. Le week-end suivant, nous projetions ces documentaires dans une salle du quartier. Nous avons fait cela pendant deux ou trois ans.»
Le ton brutal des partis de droite envers les personnes en difficultés s’exprime très ouvertement aujourd’hui. Ils ajoutent dans le même mouvement que cette aide doit cesser, car – affirment-ils – si ces personnes ont besoin d’aide, c'est précisément à cause de cette aide.» - Jean-Pierre Dardenne
Jean-Pierre: «Nos films restent très ancrés dans la réalité. Nous aimons raconter l’histoire d’un individu, son regard sur le monde, ses expériences, la complexité de ses choix.»
Luc: «En fait, c’est très simple: les gens qui sont mis dehors, on les met dedans. Ceux qui sont marginalisés dans la réalité, nous les plaçons dans notre cadre. Prenez, Rosetta, 17 ans (personnage du film éponyme qui leur a valu leur première Palme d’Or, ndlr): elle vit dans un camping avec sa mère, dans une situation précaire. Personne ne voit ni ne connaît sa réalité. Au camping, elle porte toujours ses bottes, mais dès qu’elle sort, elle enfile une autre paire de chaussures. Elle seule le sait. Cette solitude-là, c’est ce qui nous touche.»
«Nous voulons montrer comment, même enfermée dans une situation socio-économique difficile, une personne peut réussir à s’en sortir – parfois aussi grâce aux autres.»
Luc: «C’est vrai. On dit souvent que nos films sont sombres et lourds. Pourtant, ils sont aussi porteurs d’espoir. Nous savons que certaines mères adolescentes ne parviennent pas à sortir de la misère mais le cinéma nous offre la liberté de montrer ce combat. Dans Jeunes mères, nous voyons ces jeunes filles lutter pour aller à l’école, tenir le coup, tout en assumant seules la responsabilité d’un enfant. C’est extrêmement difficile. C’est pourquoi, nous cherchons toujours une issue dans nos films, aussi fragile soit-elle.»
Jean-Pierre: «Dans Jeunes mères, elles trouvent cette issue grâce au personnel du foyer maternel ou à leur entourage proche. Elles font aussi l’expérience du soutien mutuel.»
Luc: «En réalité, c’était plutôt facile. Avant le tournage, nous étions un peu inquiets, car un bébé ne se dirige pas comme un acteur. Il nous est arrivé d’interrompre une prise parce qu’un bébé pleurait fort ou avait faim. Les actrices s’étaient entraînées à tenir un bébé, lui donner le biberon, etc. Mais le plus remarquable, c’est que ces jeunes filles ont précisément trouvé du soutien dans ces bébés. Donner la réplique en tenant un bébé dans ses bras ce n’est pas du tout la même chose que si vous n’en avez pas. Il faut être attentif à ce petit être vivant. Et puis cela mettait tout le monde de bonne humeur.»
Luc: «Travailler ensemble nous paraît tout à fait naturel. Si le courant ne passait pas, mon frère dirait blanc alors que je voudrais noir et nous ferions un film gris. Mais nous ne faisons aucun compromis, nous voulons réaliser le même film. Il y a quelque chose dans notre imaginaire que nous partageons depuis l’enfance et qui nous permet de nous comprendre parfaitement depuis si longtemps. Du moins, c’est notre intuition. Nous n’avons pas encore vraiment creusé la question.» (rires)
Jean-Pierre: «Oh oui, nous avons constaté ce changement. Le ton brutal des partis de droite envers les personnes en difficultés s’exprime très ouvertement aujourd’hui. Ils ajoutent dans le même mouvement que cette aide doit cesser, car – affirment-ils – si ces personnes ont besoin d’aide, c'est précisément à cause de cette aide.»
Luc: «La mentalité du chacun pour soi est beaucoup plus forte que lorsque nous étions jeunes. Ce culte exacerbé de l’individu donne presque l’impression qu’avoir besoin des autres est une faiblesse. L’entraide n’est plus perçue comme une valeur positive. En même temps, je ressens un fort regain de solidarité – surtout chez les jeunes. C’est difficile à définir précisément, mais je le ressens clairement.»
Jean-Pierre: «Aujourd'hui, un groupe de personnes au pouvoir pense qu’il va gagner, mais je crois que ces personnes se trompent. Elles ne le savent juste pas encore.»
Luc: «Dans dix ans, elles le sauront.» (rires sonores)