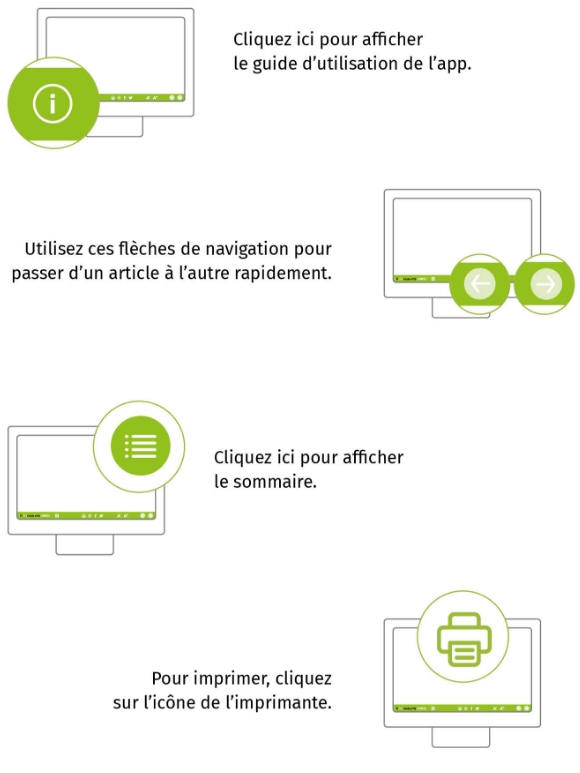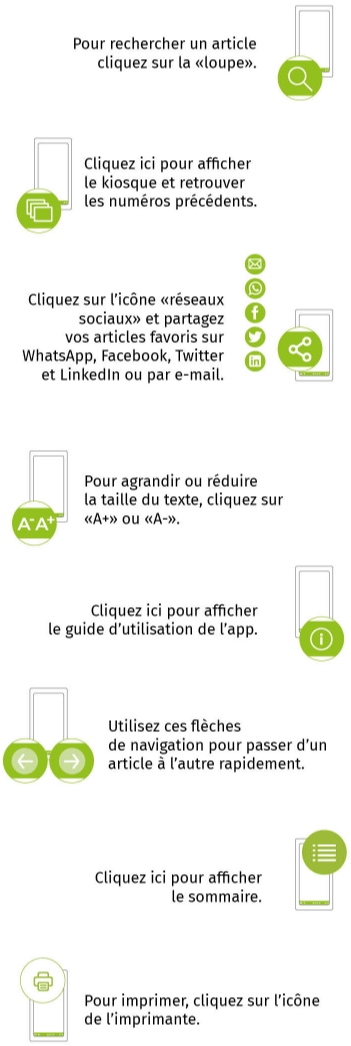Le sommaire
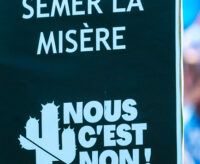












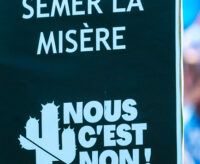












Les liens entre le monde du travail et le cinéma ressemblent à un long divorce entrecoupé de fulgurances amoureuses entre vieux amants. Car si la figure de l’ouvrier est plutôt rare aujourd’hui sur les grands écrans, ce sont pourtant des travailleurs qui auront l’honneur d’apparaître, en 1895, dans le premier film de l’histoire du cinéma: La sortie de l’usine Lumière de Lyon*.
Rapidement, le cinématographe va devenir un média dont la population ouvrière est particulièrement friande1: des histoires d’amours bourgeoises, de cow-boys, de comiques casse-cou, de héros antiques... mais aussi de travailleurs, avec ou sans emploi, comme Charlot. La société soviétique, le développement du capitalisme industriel américain et la montée en puissance du Front populaire en France vont imposer quelques figures mémorables d’ouvriers dans les fictions et mettre en scène «les tourments privés ou publics d’un ouvrier, d’un conducteur de locomotive, d’un chauffeur routier»2. Charlot, ouvrier sous pression dans l’intemporel Les Temps modernes*, ou encore Jean Gabin, qui deviendra, au fil de ses films, l’incarnation du «mythe du metallo parisien, libre, frondeur, capable de tenir tête à son patron»3, sont des figures ouvrières marquantes. Mais, malgré ces incarnations mythiques, en France, à peine plus de 1% de la production a mis en scène la classe ouvrière entre La sortie des usines Lumière et l’année 20004.
«Pour les cinéastes, l’ouvrier est généralement qualifié, héritier d’un savoir-faire. Les typos [les ouvriers du secteur du livre, NDLR] viennent en tête, suivis de près par les métallos et les «gueules noires», spécialement photogéniques. Apparaissent aussi, pour le sensationnel, quelques bâtisseurs de barrages et de ponts grandioses et un petit nombre de cheminots, occupés à dompter leurs fascinantes machines»4. Si, dans de nombreux films, l’ouvrier tente d’échapper à sa condition, sa dure réalité est dévoilée de manière crue dans le «cinéma du réel», mélangeant documentaire et fiction. Misère au Borinage* ou Déjà s’envole la fleur maigre, qui aborde la question des travailleurs étrangers à travers une famille de mineurs italiens du Borinage, préfigurent le cinéma social des Frères Dardenne (lire leur interview en page 8).
Avec Mai 68, la représentation de la réalité ouvrière connaît un regain d’intérêt. Des personnages ouvriers sont placés au premier plan dans des fictions éminemment politiques mettant en exergue la lutte des classes et dénonçant les institutions politiques, comme dans La classe ouvrière va au paradis. Dans une visée plus documentaire, un cinéma militant va mettre en lumière les conditions de travail et les luttes ouvrières. L’ouvrier prend également des traits féminins «dévoilant les industries du textile, de l’alimentaire et du jouet qui les emploient»1.
Avec l’avènement des valeurs individualistes et entrepreneuriales dans les années 80, la présence des ouvriers va se raréfier. Un ouvrier fait moins rêver quand l’argent est roi… Il faudra attendre la décennie suivante et les constats des dégâts sociaux de la politique néolibérale pour que des cinéastes anglais (Ken Loach, Mike Leigh…) ou, de notre côté de la Manche, les frères Dardenne ou Robert Guédiguian, rebâtissent des histoires ancrées dans le quotidien du monde ouvrier. Mais l’image de l’ouvrier, loin de la gouaille des années 30, se mêle désormais à celle du chômeur et, à travers elle, constate la précarisation – voire de l’extrême pauvreté – d’un nombre croissant d’entre eux.
Pour les cinéastes, l’ouvrier est généralement qualifié, héritier d’un savoir-faire. Les typos viennent en tête, suivis de près par les métallos et les «gueules noires», spécialement photogéniques.
Dans une économie qui s’est mondialisée et financiarisée, le cinéma se penche aussi désormais aussi sur le monde des cadres et du management (L’emploi du temps, Violence des échanges en milieu tempéré) à travers les dilemmes moraux et éthiques que posent les délocalisations, les restructurations et les fermetures d’usine. Des dilemmes qui font le constat de la violence économique et de la précarisation de l’emploi. «Si au départ la perte d’emploi est toujours la responsabilité de l’ouvrier, à partir des années 30, elle devient la conséquence des dysfonctionnements de l’économie et, depuis la dernière décennie, les films s’attardent sur les effets négatifs de l’inactivité forcée sur l’individu, le couple ou la famille»4.
Si un nombre important de documentaires, comme L’acier a coulé dans nos veines (Thierry Michel, 2025) se penchent sur la condition ouvrière d’ici et d’ailleurs, l’ouvrier se fait actuellement plutôt rare comme personnage de fiction. Le travailleur a plus souvent les traits d’un employé de la classe moyenne que d’un apprenti dans la construction, comme dans Enzo, actuellement en salle (à lire en page suivante). Des films tels que Nos batailles et À plein temps abordant le difficile équilibre entre travail et famille lorsque l’on est parent célibataire et chef d’équipe syndiqué, En guerre, qui suit la lutte des travailleurs pour préserver leur emploi au sein d’une entreprise qui réalise des bénéfices record ou encore Ouistreham qui traite des rythmes de travail infernaux des femmes de ménage à bord des ferries, constituent d’autres magnifiques exceptions. Mais c’est un lourd pessimisme qui entoure la figure des ouvriers et le monde du travail au cinéma, même s’il émane çà et là des lueurs d’espoir individuelles. Dans les années 30, «la classe ouvrière a été magnifiée. La place des ouvriers dans la société française a donné naissance à un idéal ouvriériste qui a masqué la complexité de la réalité»3. Mais la dure réalité a depuis longtemps rattrapé le monde ouvrier, jusque dans sa représentation au cinéma. «Les films présentant la classe ouvrière sont aussi révélateurs des peurs de l’époque, d’une classe toujours considérée comme dangereuse»1. Pour l’avenir, osons un vœu: celui d’un cinéma où l’ouvrier n’est plus seulement l’incarnation de son travail mais un citoyen lambda. Parce qu’il serait enthousiasmant de voir à l’écran, comme dans la vie, des ouvriers heureux. Comme la promesse d’un nouveau mariage.
1. «L’Écran bleu», Michel Cadé, Presse universitaire de Perpignan, coll.études, 2000.
2. «La gauche sans le peuple», Éric Conan, éditions Fayard, 2004.
3. «Classes sociales au cinéma: le peuple en marge», www.regards.fr
4. «Compte rendu de “L’Écran bleu” de Michel Cadé», par Myriam Tsikounas, Revue d’histoire moderne et contemporaine – www.rhmc.fr
*Les films avec un astérisque (*) sont disponibles gratuitement sur internet.