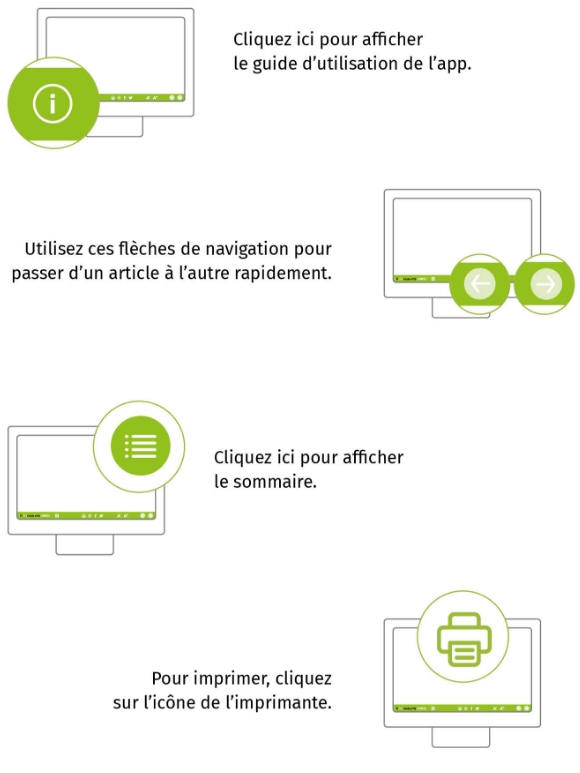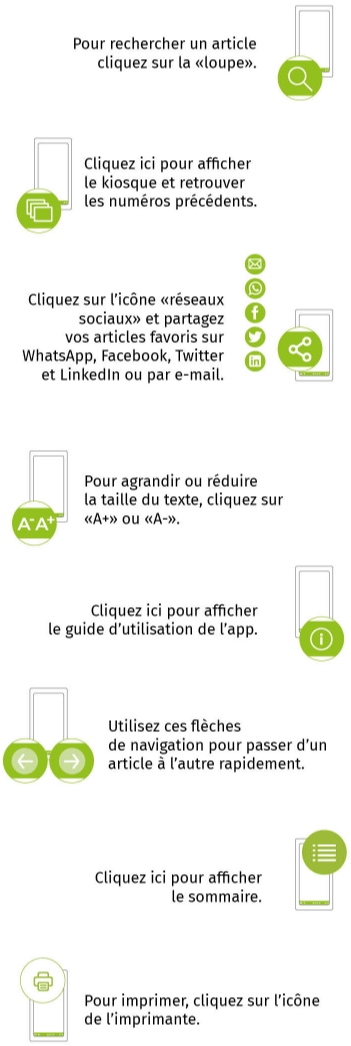Le sommaire























La prépondérance du travail effectif dans l’accès à la pension et la suppression de l’interdiction de cumul témoignent de l’évolution de la philosophie qui sous-tend le système de pension depuis une dizaine d’années. La réforme des pensions qui se prépare confirme cette transformation.
David Morelli


La CSC a plusieurs fois manifesté contre les réformes des pensions.
Le principe de base pour l’accès à la pension en Belgique, c’est qu’il faut avoir atteint l’âge légal de la pension: 66 ans aujourd’hui, 67 ans en 2030. Le montant de votre pension dépendra de votre carrière. Une autre voie d’accès à la pension de retraite est la pension anticipée. Il ne suffit plus ici de remplir des conditions d’âge: il faut aussi remplir les conditions de carrière. Jusqu’en 2013, chez les salariés comme chez les indépendants, il fallait avoir atteint l’âge de 60 ans et 35 années de carrière qui incluaient les périodes assimilées: chômage indemnisé, maladie indemnisée par la mutuelle, incapacité de travail suite à un accident du travail, etc. Ces conditions d’accès ont été durcies par le gouvernement Di Rupo et renforcées sous le gouvernement Michel: il faut maintenant avoir 63 ans et 42 années de carrière.
Le gouvernement Arizona va à son tour renforcer le poids de la carrière passée, sur le montant de la pension cette fois. D’abord avec l’introduction du système de bonus-malus. Ce système, qui remplace le bonus introduit par le gouvernement De Croo en toute fin de législature, témoigne de l’évolution de la philosophie des pensions à travers la forte limitation de la prise en compte des périodes dites «assimilées». Dès 2027, seules les années comprenant 156 jours effectivement prestés seront comptabilisées pour éviter le malus. Ensuite, les périodes d’interruption ne seront comptées que partiellement, voire pas du tout, si elles dépassent un certain plafond. «Les périodes assimilées, qui permettent notamment de réduire les inégalités de pension entre les hommes et les femmes, vont jouer un rôle moins important à l’avenir du fait de leur plafonnement et de l’introduction ou l’augmentation des conditions de travail effectif», analysait Quentin Detienne, professeur de droit de la sécurité sociale à l’ULiège, à l’occasion d’un séminaire organisé sur ce thème par la CSC.
Il est utile à cet égard de rappeler que les périodes assimilées constituaient en moyenne 39% de la carrière des femmes (30% pour les hommes). La montée en importance du travail effectif dans le calcul de la carrière risque donc d’impacter plus lourdement les femmes que les hommes et d’augmenter l’écart de pension qui, sans périodes assimilées, atteindrait… 43%! Pour le juriste, ces mesurent risquent en effet de peser beaucoup sur les carrières avec beaucoup d’’intermittences, de période de non-travail et de temps partiel.
«On constate une tendance dans les réformes à renforcer le lien entre travail effectif et pensions, que ce soit pour le montant ou pour l’accès à la pension. C’est lié à une certaine conception de la pension de retraite, une logique comptable qui renforce l’aspect contributif du système: on reçoit en contrepartie de la contribution préalable, en espèce sonnante et trébuchante, durant la carrière», analyse le professeur.
Pour Quentin Detienne, la réforme annoncée va également plus largement dans le sens du développement du second pilier de pension. «On réduit ou on contient le développement du premier pilier, les pensions légales versées par la sécurité sociale, et on encourage le développement d’un second pilier en capitalisation.» Ce qui constitue, également, une évolution non négligeable de la philosophie du système de pension.
Continuer de travailler après la retraite change fondamentalement la philosophie du système.
Mais c’est peut-être une mesure technique qui incarne le mieux l’évolution de la philosophie du système: la fin de l’interdiction de cumuler la pension de retraite avec d’autres revenus. «Dans le passé, pour avoir droit à une pension de retraite, il fallait avoir cessé de de percevoir un revenu professionnel, développe le professeur. Si on recommençait à travailler ou si on n’arrêtait pas de travailler alors qu’on en avait le droit, le paiement de la pension était suspendu. Techniquement, c’était une interdiction de cumul. Aujourd’hui, cette interdiction de cumul, c’est terminé».
Adopté sous le gouvernement Michel, le principe de suppression de toute limite au cumul autorisé entre une pension de retraite et les revenus professionnels est toujours d’application dans la réforme des pensions envisagée par l’Arizona. En d’autres termes, les personnes ayant atteint l’âge légal de la retraite peuvent désormais cumuler sans limite leur pension de retraite et des revenus professionnels. Il n’y a donc plus, factuellement, de limite d’âge chez les salariés. «Puisqu’on peut continuer à travailler en étant à la “retraite”, les pensions de retraite sont devenues, sans qu’on en ait bien pris la mesure, une assurance vieillesse, c’est à dire une rente qui vous est payée à partir du moment où vous atteignez un certain âge, éventuellement combiné à une certaine condition de carrière. Mais une fois que vous avez atteint cet âge, libre à vous de continuer à travailler ou pas». Le montant du revenu octroyé, calculé à titre individuel, ne varie pas selon le niveau d’activité. «Cela change fondamentalement la philosophie du système puisque la retraite n’est plus envisagée comme le moment de la vie où on est censé se retirer du marché du travail pour s’occuper d’autres choses». D’une certaine façon, nos pensions de retraite sont devenues une sorte de revenu de base garanti pour personnes âgées.
Cette nouvelle donne aura sans doute des incidences sur le marché de l’emploi. «Les personnes qui veulent continuer à travailler à l’âge de 66 ans et qui ont la garantie de recevoir un revenu tous les mois, en plus de leur salaire, constituent une force de travail intéressante sur le marché. Elles sont en effet susceptibles d’accepter des conditions salariales moins exigeantes que ceux qui ne reçoivent pas un montant garanti tous les mois», conclut le professeur de l’ULiège.
Une chose qui ne change pas par contre, pointe le professeur de l’ULiège, c’est que le système de retraite est aveugle à la réalité concrète du travail. «Le calcul de la pension repose sur une formule générale abstraite qui s’applique pour l’ensemble du régime des salariés, avec des variations marginales. Peu importe que vous soyez manœuvre sur un chantier ou cadre très bien rémunéré, avec des réalités quotidiennes et des espérances de vie très différentes. L’activité concrète exercée ne transparait d’aucune façon dans le système de retraite. Un des rares exemples où on tient compte de la réalité exercée, c’est dans les tantièmes préférentiels du régime des statutaires… qui constituaient, en quelque sorte, une contrepartie à la pénibilité du travail et aux charges physiques et mentales, chez les enseignants, les facteurs ou les cheminots par exemple. Ces tantièmes devraient disparaître dans le cadre de la réforme…».
© Shutterstock