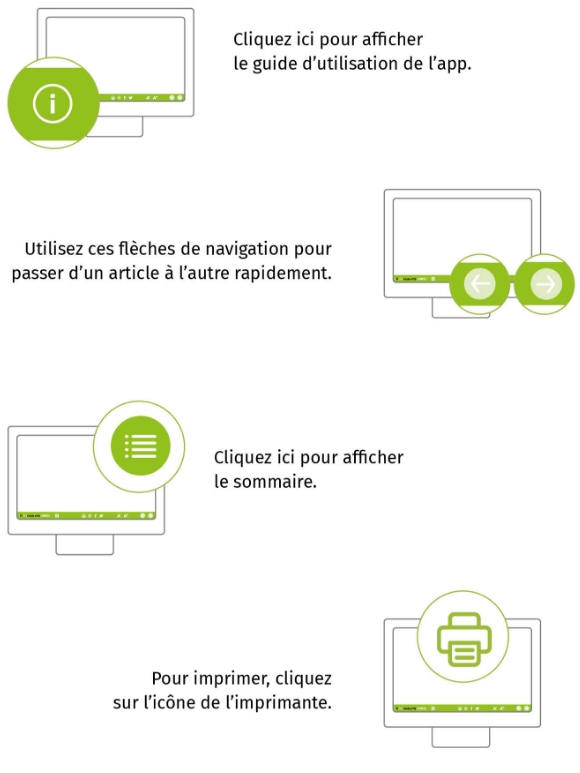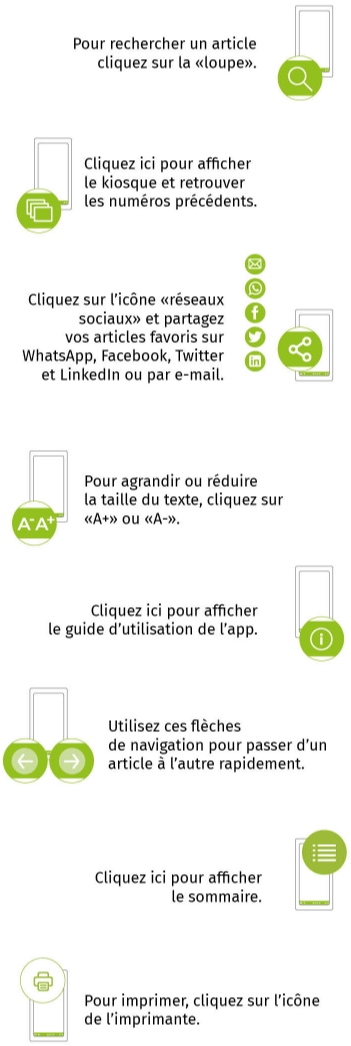Le sommaire





































Les troubles géopolitiques se sont poursuivis tout au long de l’été et continueront à peser pendant la prochaine année sociale. Pendant ce temps, la coalition Arizona poursuit obstinément sa flexibilisation du marché du travail.
Maarten Gerard
La guerre et la crise humanitaire en cours à Gaza, où un génocide est perpétré sous nos yeux, continuent de dominer l'agenda international. La prise de position timide du gouvernement n'est pas convaincante, comme la forte mobilisation lors de la manifestation en faveur de Gaza a pu le démontrer. Le conflit en Ukraine ne semble pas non plus près de se terminer. Sans oublier les nombreux autres conflits graves qui se poursuivent, notamment au Soudan, au Myanmar et dans l'est du Congo. On y assiste également à de graves violations des droits humains, qui nécessitent une attention internationale et un engagement syndical. La violation des droits des travailleurs dans n'importe quel pays affecte les travailleurs du monde entier.
Au cours de l'année à venir, les changements dans la politique commerciale internationale se feront sentir. La volonté du président Trump d'imposer des droits de douane à tout le monde a débouché cet été sur un accord avec l'Union européenne visant à imposer des droits de douane de 15 % sur tous les produits exportés par l'UE vers le marché américain. Entre-temps, ces taxes sont contestées juridiquement, mais l'incertitude qui en résulte aura indéniablement un impact sur notre commerce avec les États-Unis, et donc sur notre économie. La question est de savoir si, dans sa recherche d’autres partenaires commerciaux, l'Europe mettra l'accent sur des critères sociaux et de durabilité ou si elle abaissera la barre afin de pouvoir conclure des accords. Il semble que ce deuxième choix prévale dans l'accord sur le Mercosur qui est sur la table : un accord de libre-échange entre l'UE et un certain nombre de pays d'Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie).
Les conventions internationales conclues par l'intermédiaire d'institutions internationales jouent néanmoins un rôle important dans la défense des droits du travail et des droits humains. En juin, l'Organisation internationale du travail (OIT) a accordé à la Palestine le statut d’ «État observateur non membre», ce qui constitue une étape importante dans la reconnaissance des droits des Palestiniens. L'OIT applique également l'article 33 des Statuts de l'OIT à la Biélorussie et au Myanmar. Cet article prévoit qu'un Etat membre est exclu des programmes de l'OIT et/ou doit passer par des procédures spéciales en raison de violations fréquentes et graves des conventions de l'OIT. En ces temps d'instabilité internationale, ce sont des signaux importants. Fin août, l'OIT est d’ailleurs entrée dans le collimateur des États-Unis, qui ont annoncé dans un décret présidentiel qu'ils cesseraient de financer l'OIT, ainsi que de nombreuses autres organisations onusiennes et organisations d'aide internationale. «L'OIT encourage la syndicalisation des travailleurs étrangers et nuit ainsi aux intérêts de nos entreprises», telle était la motivation. En d’autres mots, les entreprises américaines doivent pouvoir exploiter sans vergogne les travailleurs qui ne proviennent pas des États-Unis. Le passage sur l'OIT a disparu quelques jours plus tard, mais il en dit long sur ce que l'on peut craindre des États-Unis en termes de droits humains et syndicaux. Nous attendons avec impatience l'arrêt de la Cour internationale de Justice sur le droit de grève. Le Conseil d'administration y a soumis un différend entre les délégations des employeurs et des travailleurs à ce sujet. Si la Cour internationale de Justice suit le raisonnement des employeurs, selon lequel la Convention 87 sur la liberté syndicale n'inclut pas le droit de grève – ce qui était l'opinion dominante au sein de l'OIT, les choses se présentent mal pour de nombreux syndicats dans le monde.
En juin, l'Organisation internationale du travail (OIT) a accordé à la Palestine le statut d’«État observateur non membre», ce qui constitue une étape importante dans la reconnaissance des droits des Palestiniens.
Les interlocuteurs sociaux n’ont pas pu se mettre d’accord sur la marge salariale avant l’été. Les employeurs n’ont pas voulu bouger d’un pouce. En conséquence, il est revenu au gouvernement de prendre une décision. Compte tenu de la composition du gouvernement, on ne pouvait pas en attendre grand-chose. Le gouvernement a confirmé la marge salariale de 0% dans son accord d’été. A partir de 2026, les employeurs pourront toutefois augmenter la valeur des chèques-repas de (maximum) 2 euros, sans que cela ne s’inscrive dans la marge salariale stricte. L’article 10 de la Loi sur la norme salariale s’appliquera. L’introduction de chèques-repas là où ils ne sont pas encore d’application est donc possible. Les entreprises qui octroient le nouveau montant maximum (une intervention de 8,91 euros) bénéficieront d’une déduction fiscale supplémentaire et pourront déduire 4 euros par chèque, au lieu de 2 euros. Si le montant est inférieur, ils n’auront droit qu’à la déduction actuelle de 2 euros. L’accord politique est un compromis, avec une avancée limitée, mais il offre au moins aux secteurs et aux entreprises la possibilité d’augmenter les chèques-repas en dehors de la norme salariale. Cet avantage ne profitera toutefois pas à tous les travailleurs et la facture pour la norme salariale reviendra de toute façon au prochain tour.
Cet été, nous avons pu trouver un accord avec les employeurs au Conseil national du Travail (CNT) sur les fins de carrière et les prolongations classiques liées à un accord interprofessionnel (AIP). Le gouvernement a indiqué qu'il suivrait cet accord social du CNT dans son intégralité. Cela signifie qu'il y aura des ajustements aux régimes transitoires RCC et emplois de fin de carrière et que ces derniers, tout comme le chômage temporaire, devront toujours donner les mêmes droits en matière de sécurité sociale qu'auparavant. Compte tenu des délais serrés et de l'incertitude quant à l'attitude du gouvernement, des CCT temporaires ont été conclues au CNT jusque fin 2025 sur les emplois de fin de carrière et le RCC médical. Dès qu'il y aura des certitudes sur les arrêtés royaux RCC et emplois de fin de carrière, ainsi que plus de clarté sur l’assimilation du chômage temporaire et des emplois de fin de carrière pour la pension, les nouvelles CCT pourront être conclues pour le RCC médical, le chômage économique des employés et les emplois de fin de carrière. À partir de ce moment-là, les secteurs pourront s’aligner.
À la demande des interlocuteurs sociaux, le gouvernement a également déposé un arrêté royal (AR) sur la prolongation de la cotisation groupes à risques pour 2025-2026 et l’a approuvé le 5 septembre. Les secteurs doivent déposer leurs CCT pour les cotisations aux fonds groupes à risques avant le 1er octobre.
Des demandes d’avis sont également sur la table du CNT concernant l’élargissement des flexi-jobs, l'annualisation, la réintroduction de la période d'essai et, surtout, la Loi dispositions diverses relatives au travail. Cette dernière porte notamment sur la suppression de la durée du travail de minimum 1/3 temps, la limitation du préavis maximal et l’élargissement des heures supplémentaires. Les demandes d’avis adressées au CNT portent également sur l’enregistrement du temps de travail et la définition des contrats d'appel. Un cocktail toxique qui semble être fait pour démanteler systématiquement le marché du travail sur le long terme, avec des contrats courts sans sécurité et une remise en cause de droits sociaux. Il reste à voir si les employeurs se rendront compte qu'ils risquent ainsi de brûler leur propre réserve de main-d'œuvre, au moment même où ils réclament plus de travailleurs. Force est également de constater que les accords et les prérogatives de la concertation sociale sont pris très à légère, avec notamment une violation flagrante des CCT sur les opt-out aux flexi-jobs, les primes sur le travail de nuit, etc. Sans parler des directives européennes et des conventions internationales.
Les dispositions prévues concernant l’élargissement des heures supplémentaires – ce qui relève en fait de la négociation interprofessionnelle – entreront en vigueur en 2026 au plus tôt. Entre-temps, le gouvernement a déjà accordé aux employeurs une prolongation des heures de relance jusque fin 2025. Le crédit de 120 heures de relance par travailleur (heures supplémentaires qui viennent s’ajouter au contingent légal de base de 100 heures supplémentaires volontaires) reste d’application jusque fin 2025, au lieu du 30 juin 2025 comme prévu dans le cadre d’accords. Ces heures peuvent donc être utilisées pendant six mois supplémentaires.
© Shutterstock