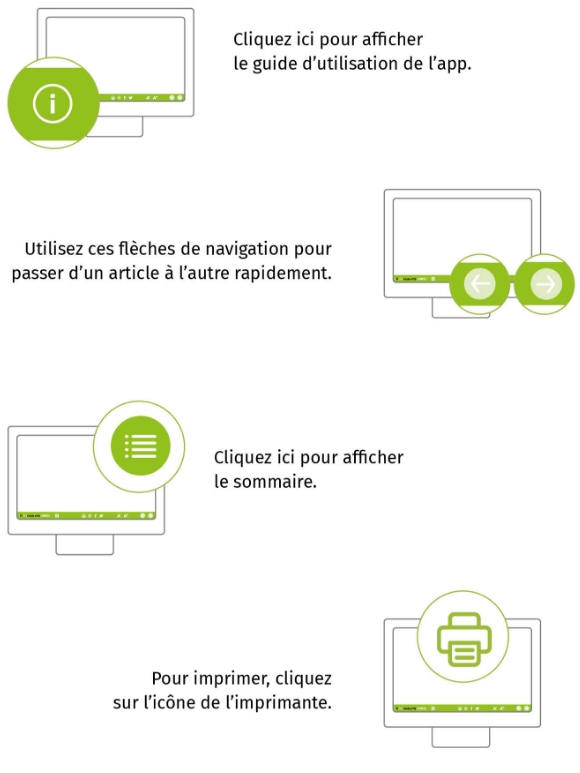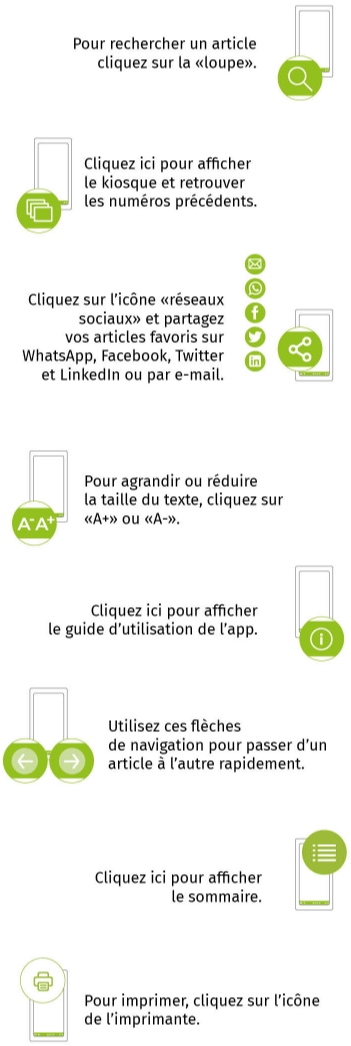Le sommaire
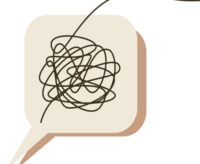












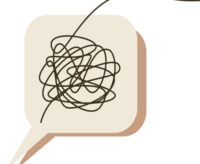













Du 10 au 21 novembre, la ville brésilienne de Belém accueillera la 30e Conférence des parties (COP), le sommet mondial annuel consacré à la lutte contre le réchauffement climatique. Malgré l’urgence, l’élan international semble aujourd’hui s’essouffler quelque peu. Le chercheur américain Aaron Niederman mène une étude sur la manière dont les syndicats et les militants (du climat) peuvent (mieux) s’organiser pour poursuivre les objectifs d’une transition juste.
Prop. recueiL. par F. Vandamme & P. Van Looveren
Malgré toutes les preuves scientifiques que la terre se réchauffe avec des conséquences désastreuses, les climatosceptiques continuent de nier l’évidence. Le président américain, qualifiant le changement climatique de «grande escroquerie», a retiré les États-Unis de l’Accord de Paris sur le climat. À l’évocation de Trump, Aaron Niederman soupire: «Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Même à l’échelle locale – dans votre entreprise ou votre quartier – vous pouvez prendre de nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable et lutter contre le réchauffement climatique».
Dans les soixante initiatives que j’ai étudiées, quatre éléments reviennent régulièrement, même s’ils n’ont pas été pleinement réalisés partout. Premièrement, vous devez disposer d’une base de travailleurs solidement organisée. Deuxièmement, vous devez bénéficier du soutien de la communauté. En Allemagne, de larges alliances et des collaborations étroites renforcent la légitimité et la capacité d’action. Les syndicats des transports publics ont uni leurs forces à celles des usagers et des défenseurs du climat. Cette dynamique est également visible dans le secteur des soins de santé. Troisièmement, vous devez avoir un plan alternatif. En Italie, les travailleurs de l’usine automobile GKN à Florence ont opté, aux côtés de chercheurs et de militants pour le climat, pour un projet de reconversion en fabriquant des vélos électriques et bientôt des panneaux solaires. Quatrièmement, vous devez chercher des financements et identifier les investissements publics nécessaires et possible. Une transition coûte de l’argent. Enfin, la force des syndicats reste cruciale. Mais ils doivent élaborer des plans proactifs. Trop souvent, ils ne réagissent que lorsque la menace de licenciements pèse sur les travailleurs.
Même à l’échelle locale vous pouvez prendre de nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable.
On peut en effet se demander à qui revient la responsabilité d’élaborer un tel plan de transition. Cependant, si nous voulons vraiment que les travailleurs obtiennent justice, nous ne pouvons pas nous contenter de laisser les employeurs décider seuls. Leurs choix aboutissent trop souvent à des suppressions d’emplois et à la dégradation des conditions de travail. C’est pourquoi les syndicats doivent jouer ce rôle. Il s’agit d’une nouvelle ligne de front: ne pas seulement lutter contre les restructurations, mais contribuer activement à orienter les entreprises vers une économie durable et un nouveau mode de production. Élaborer des plans alternatifs nécessite une collaboration: avec des militants pour le climat, des chercheurs scientifiques et des experts techniques ou économiques. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer les travailleurs. Ils connaissent mieux que quiconque leurs compétences et les outils de production de leurs usines. Le plan Lucas (lire encadré), lancé dans les années 1970, en est un exemple emblématique. Les travailleurs avaient alors développé plus d’une centaine d’idées de produits innovants. Ce cas montre à quel point le potentiel est immense lorsque les travailleurs disposent de l’espace et du soutien nécessaires pour contribuer à façonner leur avenir.


30.000 personnes ont marché le 5 octobre 2025 à Bruxelles pour rappeler l’urgence d’agir pour le climat.
Les syndicats apportent la légitimité, la force organisationnelle et la capacité de mobilisation. De leur côté, les militants pour le climat excellent dans la création de campagnes et d’actions percutantes. Ensemble, ils peuvent avoir bien plus d’impact qu’en agissant individuellement.
Cela signifie que les syndicats ne s’intéressent pas seulement aux conditions de travail de leurs membres dans leurs négociations, mais aussi au bien-être de la communauté. Par exemple, les enseignants associent leurs conditions de travail à de meilleures conditions d’apprentissage pour les enfants, les infirmières à la qualité des soins pour les patients. En intégrant la dimension de bien commun, ils renforcent l’adhésion de la communauté et ouvrent la voie à une collaboration avec d’autres acteurs, notamment les militants climatiques, sur des thèmes tels que la transition juste ou les écoles durables.
Tout un réseau s’est développé aux États-Unis autour de cette technique d’organisation, avec de nombreuses campagnes innovantes.
Originaire de Skokie, dans l’Illinois, ce chercheur américain travaille actuellement à Berlin. Il mène des recherches en sciences sociales appliquées, notamment sur la manière dont les syndicats et les militants peuvent s’organiser pour poursuivre les objectifs d’une transition juste, c’est-à-dire qui intègre les dimensions sociales et économiques dans le cadre de la transition vers une économie neutre sur le plan climatique Dans ce cadre, il a analysé une soixantaine d’initiatives à travers le monde.
Le plan Lucas est une initiative pionnière lancée en 1976 par les collaborateurs du fabricant d’armes britannique Lucas Aerospace. L’entreprise, spécialisée dans la production de composants pour l’aéronautique et la technologie militaire, faisait face à des menaces de licenciements. En réponse, les travailleurs ont proposé un projet de reconversion ambitieux: transformer l’entreprise pour produire des biens utiles et pacifiques tels que des éoliennes, des fauteuils roulants et des équipements médicaux, des technologies respectueuses de l’environnement…
© Donatienne Coppieters